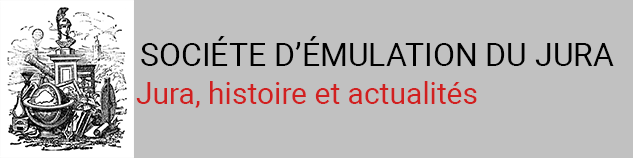La prochaine séance de la Société aura lieu le samedi 21 février 2026, à 15 heures, aux Archives départementales du Jura. Au programme :
Jean Michel Bonjean, L’affaire des drapeaux du Sacré Cœur aux Bouchoux (1890-1904)
La découverte intrigante dans les sacristies ou les greniers de nombreuses églises jurassiennes d’un drapeau tricolore orné de l’image du Sacré-cœur est à l’origine de cette recherche. Le culte de latrie du Sacré-cœur apparaît sous l’Ancien Régime, mais c’est la confrontation de l’Église avec l’institution de la République au XIXe siècle qui va lui faire prendre une importance inattendue. La présence de cette image au village acquiert alors un caractère émotionnel particulier. Divers documents permettent au chercheur de donner corps à son usage, devenu très sensible dans la population, dans un temps très court, entre 1890 et 1904. Cet épisode politique et social est à replacer dans un ensemble d’attitudes non dénuées d’arrière-pensées ni d’ancrage local qui en font toute la saveur, même si de nos jours tous ces événements sont tombés dans l’oubli.
L’exemple des Bouchoux, bien documenté, permet d’approfondir la question.
Jean Olivier Mottet de La Fontaine, Un érudit comtois : Abry d’Arcier
Le 30 juillet 1824, après trois mois de grandes souffrances, Abry d’Arcier rend son âme à Dieu à 9 heures du soir. La déclaration de décès est effectuée le lendemain en présence du maire, de son gendre et d’un voisin. Sa petite-fille, madame Regaud, témoigne dans ses notes : « la population d’Arlay rendit hommage à la mémoire de mon bon grand-père, elle assista en très grand nombre à son enterrement… ils perdaient en lui non seulement un ami mais aussi un père et un protecteur, pas un seul n’avait oublié ses bienfaits ». Deux cents ans après sa mort, en tant que dépositaire des archives familiales, il est important pour J. O. Mottet de rendre hommage à cet aïeul qui a su conserver les souvenirs du passé et servir l’histoire locale.
J.O. Mottet, tout en s’appuyant sur l’étude d’A. Vaissière publiée dans les Mémoires de la Société d’émulation du Jura en 1882, la complétera grâce à l’apport d’archives privées inédites. Il présentera l’origine de la famille Abry, son arbre généalogique, son implantation géographique et les documents originaux relatifs aux charges acquises par le père et le grand-père de l’érudit. Il reviendra sur le goût précoce d’Abry d’Arcier pour les recherches historiques.